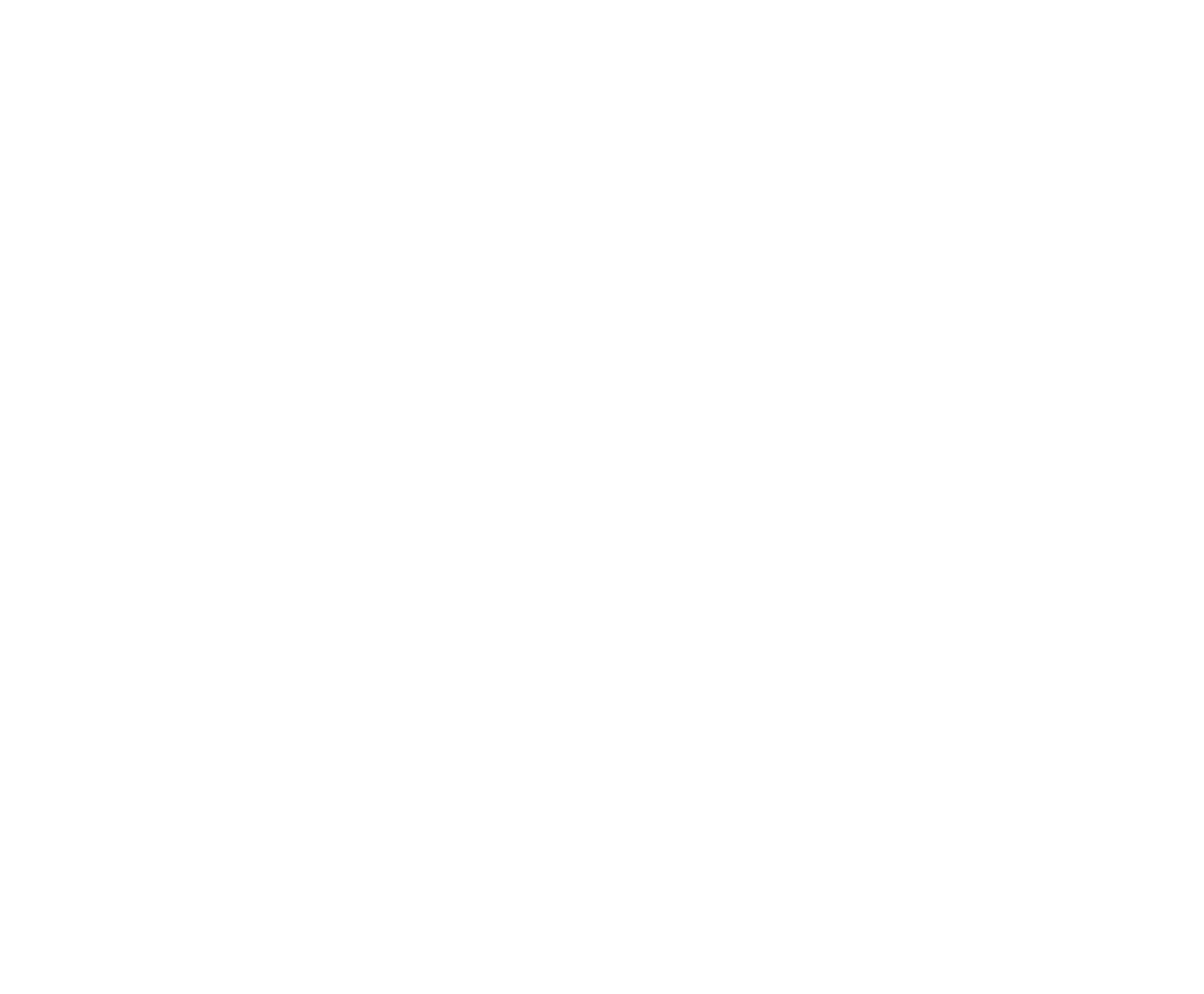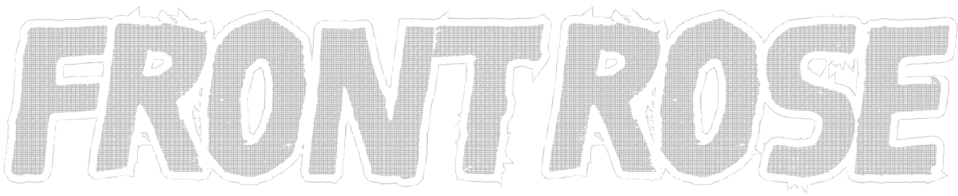Autonomie queer et défense des squats : Entretien avec les Digitales
En octobre 2025, les Digitales — un collectif de défense des squats — était de passage à Montréal à l’invitation du FLIP1. À cette occasion, l’ORA (Organisation révolutionnaire anarchiste) et Front rose ont rencontré Eli, membre du collectif et ex habitante de la Baudrière (un squat transpédégouine de Montreuil ayant été ouvert en 2021 et expulsé en 2023) pour une discussion sur les formes d’habitation et de lutte queer.
La discussion était menée conjointement par Pob, membre de l’Organisation Révolutionnaire Anarchiste (ORA), et Louve Rose de Front Rose. La rencontre, qui s’est déroulée à l’Achoppe (un lieu autogéré dans le quartier Hochelaga se rapprochant, en termes d’organisation, de ce qu’on retrouve dans plusieurs squats européens), a donné lieu à cet entretien, ainsi qu’à un épisode du podcast l’Orage,que vous pouvez écouter en intégralité sur l’ORAGE, le podcast de l’ORA.

Pob : Depuis plus de vingt ans maintenant, on n’a pas vu de squat d’organisation politique ici. Donc on va peut-être commencer par expliquer ce que c’est, pour vous, un squat d’organisation politique, avant de voir les spécificités de la Baudrière. Eli, tu veux résumer un peu, pour des personnes qui n’ont jamais vécu dans des squats, les différences entre un squat d’habitation et un squat d’organisation politique ?
Eli : Dans un squat d’organisation politique, il y a d’abord une volonté d’ouvrir l’organisation et l’espace à toutes les personnes extérieures qui auraient envie de venir s’organiser dans cet espace-là. Ensuite, il y a les spécificités : nous, on a choisi d’avoir un squat porté sur des questions anarcha-féministes et TransPédéGouines (TPG). Ça donne une forme de squat d’organisation qui porte certaines valeurs politiques, qui cherche à créer une autonomie queer.
Louve Rose : Ce sont des mots qu’on utilise aussi, ceux d’autonomie queer. Je pense qu’il y a ici, de plus en plus, l’idée d’essayer de faire émerger un mouvement queer authentiquement révolutionnaire. C’est un projet en construction, depuis quelques années à Montréal, avec différentes forces qui tentent d’articuler ce que ça pourrait vouloir dire, et où la question de l’autonomie est de plus en plus mise de l’avant. Tous les trois mois, quelqu’un penses à ouvrir un squat queer à Montréal et se heurte aux difficultés locales : la répression, l’absence de culture du squat, etc. Ici, il n’y a pas de cadres juridiques qui nous protègent comme en France : l’expulsion est immédiate. Si tu vis dix ans dans un squat, tu restes toujours en infraction, il n’y a pas de protection juridique des squatteurs.
P : Justement, Eli, est-ce que tu peux parler de la situation actuelle de la Baudrière, expulsée après l’adoption de la loi Kasbarian, et de la situation des squats aujourd’hui en Île-de-France ?
E : La Baudrière a été expulsée il y a plus de deux ans. Deux mois avant notre expulsion, la loi Kasbarian est passée, juste avant les Jeux Olympiques. La loi Kasbarian pénalise le fait de squatter : on peut désormais te virer directement, comme à Montréal, sans recours possible. Cela a permis un énorme nettoyage en Île-de-France, d’où ont été virés tous les espaces d’organisation autonome. Cette loi, en plus du contexte des JO, a fait qu’ouvrir de nouveaux squats est devenu quasiment impossible. Les gens de la Baudrière n’ont jamais réussi à rouvrir de squat depuis, même s’il y a eu plein de tentatives.
P : On a commencé par la fin, mais est-ce que tu peux raconter le début de la Baudrière ? Vous vous présentiez comme un squat anarcha-féministe par et pour les personnes TPG. Est-ce que tu peux nous expliquer l’utilisation de ce terme avec lequel on est moins familier·ères ici? Et d’où vient le désir, pour des personnes TPG, d’ouvrir un squat ?
E : En France, dans certains milieux queer révolutionnaires, on utilise le terme TransPédéGouine, parce que c’est une histoire qui nous parle et que ce n’est pas un terme anglophone. Il a été beaucoup moins récupéré par les institutions que le terme « queer ». En ce qui concerne le début de la Baud, on s’est toustes rencontré·es avant l’ouverture, en 2019. On était pour la plupart encore au lycée et on militait dans Youth for Climate. C’était aussi la période des Gilets jaunes : beaucoup d’entre nous ont navigué dans des milieux militants très différents. Ensuite, on a commencé à traîner avec des collectifs de Paris qui luttaient contre la gentrification. On a organisé un camp climat à Sainte-Marthe[2], et la police ne venait pas sur place lors du camp, ce qui nous a permis d’ouvrir énormément de squats là-bas. On s’opposait à la gentrification portée par de grands promoteurs immobiliers rachetant tous les bas d’immeubles pour en faire des concept stores. C’est là qu’on a commencé à expérimenter une pratique d’autogestion beaucoup plus forte : cantines, vie de quartier, organisation collective. Certains vivaient sur place, dans les squats naissants.
Au fur et à mesure que nos pratiques militantes se sont ancrées dans nos vies quotidiennes, on est entré·es dans le milieu du squat de Montreuil. Beaucoup d’entre nous voulaient que le militantisme ne soit pas une « activité extrascolaire » mais une façon de vivre, cohérente avec nos idées. Une amie vivait dans un squat montreuillois plus ancien, avec des pratiques autonomes, mais ce n’était pas un milieu où on se sentait à l’aise. On était un groupe queer et jeune et on arrivait dans un milieu anarchiste avec des codes très anciens, un repli sur soi, une hostilité aux nouvelleaux. Les savoirs ne se transmettaient pas, même quand on le demandait explicitement : Comment ouvrir un squat ? Comment gérer l’orga ? etc. Si tu n’entrais pas parfaitement dans leurs codes, tu ne pouvais pas t’organiser avec elleux. Il y avait eu des tentatives de dynamique féministes , mais les dynamiques de pouvoir restaient très fortes.
C’est pour ça qu’on a voulu créer un espace d’organisation et de vie nous ressemblant. Il a fallu se battre pour être accepté·es dans le milieu du squat, mais on a aussi imposé nos pratiques et nos visions.
P : Votre collectif souligne souvent l’importance de la transmission de savoirs de manière intergénérationnelle et entre TPG. Comment vous la pratiquiez à la Baudrière ?
E : Déjà, le simple fait de créer un espace d’organisation explicitement anarcha-féministe et TransPédéGouine faisait que des personnes pouvaient arriver plus facilement : elles savaient qu’elles ne se heurteraient pas aux violences présentes dans d’autres milieux anarchistes.
Avant l’ouverture, on a contacté des collectifs avec lesquels on voulait s’organiser, notamment le FLIRT, un collectif d’auto-support pour personnes transfem. Le squat est un espace d’organisation, mais aussi un espace de soutien matériel pour nos communautés. Très vite, on a rencontré plein de collectifs. Et puis squatter est aussi une forme de propagande par les faits : ça motivait d’autres personnes à se dire « nous aussi on peut le faire », ça envoyait le message que ce n’était pas réservé à un petit groupe sombre et fermé. La Baud était un lieu joyeux. Pareil au Malaqueen3. Là où, dans d’autres squats, tout le monde tirait la gueule, à la Baudrière, on changeait la vision de l’autonomie anarchiste en montrant tout simplement que l’autonomie queer pouvait être festive, déviante et ouverte.
LR : Historiquement, la fête est un élément central de la culture queer, de la survie collective. Ici, à Montréal, il y a déjà eu des formes d’autonomie queer, mais les gens l’ont oubliée. Il y a eu des gros collectifs queer, même si le seulqui reste dans les mémoires populaires c’est Parthenais, parce qu’un film a été fait sur son expulsion4. Ce qui faisait communauté, c’était la fête. Faire la fête politiquement, collectivement, c’est faire exister une autonomie.
E : Oui, la joie était aussi une forme de survie communautaire. Les milieux queer vivent des choses dures, beaucoup d’entre nous ont vécu des traumatismes. Ramener de la joie était une manière de survivre ensemble.
En ce qui concerne la transmission, quand on a ouvert la Baudrière, il y avait plein de personnes, des milieux queer et féministes révolutionnaires qui avaient déjà disparu, qui avaient été oublié·es du milieu montreuillois ou féministes révolutionnaires. Parce qu’à certains moments, il y avait tellement de violence, et qu’il fallait se battre constamment face à un milieu squat anarchiste qui était mascu. En ouvrant la Baudrière, toutes ces personnes-là, on les a revues, et on a pu avoir accès à une histoire et à des vies montreuilloises. Par exemple, on a découvert que, dans les années 2008, il y avait un squat à Montreuil qui se disait queer. Bon, en fait, il y avait que deux pédales dedans, mais qu’il y ait eu un squat queer à Montreuil, ça nous a impressionné·es. Pourquoi les gens ne nous ont pas dit ça ? Pourquoi les gens ne nous ont pas transmis ce truc-là ? Ça m’a beaucoup marquée et ça a beaucoup affecté ma construction à la Baudrière, de comprendre comment nos milieux disparaissent et meurent.
P : Ils peuvent aussi être oubliés, invisibilisés par la « grande histoire » des squats. C’est quelque chose que vous essayez de contrer avec les Digitales par la transmission des histoires et des savoirs. Vous le faites notamment en archivant et en cartographiant les squats et leurs histoires, en animant des podcasts, etc. J’ai l’impression que votre message c’est : ça a déjà existé, on peut donc le refaire.
Dans l’histoire des squats y a des moments de repli et des moments plus offensifs. Vous avez vécu les deux, lors de mouvements écolo et sociaux d’ampleurs, pendant les Gilets Jaunes, puis avec la covid qui a mené à un repli du mouvement social.
En tant que squat d’organisation politique, anarcha-féministe et TransPédéGouine, comment avez-vous vécu ces moments pré-insurrectionnels, où vous étiez une base arrière et logistique, et ces moments de repli, où vous vous organisiez autrement, en vous concentrant sur la vie quotidienne dans un espace militant ?
A côté de la mobilisation et dans les périodes de repli, de pause des mouvements sociaux, vous organisez, avec les Digitales, des festivals, des moments aussi d’éducation populaire, de fêtes. Comment s’organise ce collectif et comment ça a justement survécu à l’expulsion de la Baudrière ?
E : Avec le squat, on avait énormément de ressources, on pouvait se mobiliser très facilement et surtout très rapidement pendant des moments de lutte, en tout cas à Paris et en Île-de-France. On était entre 15 et 20, parfois on venait avec de la bouffe, parfois on venait juste pour les manifs. Le lieu était alors un moyen de pouvoir exister dans la lutte et de pouvoir créer des liens avec d’autres collectifs.
Dès le début de la Baudrière, la question, c’était l’habiter en ville : habiter en ville dignement, se battre contre les dynamiques de gentrification, etc. On avait envie de continuer à porter ces réflexions, donc assez rapidement on a voulu créer un collectif qui puisse durer au-delà de l’espace du squat. C’est comme ça que les Digitales sont nées, en parallèle du squat.
On a donc fait un premier festival des Digitales à la Baudrière, et pas mal de personnes en lutte sont venues, notamment de Berlin et de la ZAD (zone à défendre) de Lützerath, en Allemagne. Iels sont venues nous parler de leur combat, de comment iels luttaient. Ces festivals, c’était l’occasion de rencontrer des personnes et des luttes qui nous ressemblaient, c’était des moments de transmission.
Les deux premières Digitales se sont tenues à la Baudrière. Pour la troisième, on avait été expulsé quelques jours avant, donc on l’a fait dans un lieu ami à Montreuil, la Parole errante. Ça été un énorme événement, le dernier festival en lien avec notre squat. Parce que les Digitales étaient devenu un collectif avec plein de personnes extérieures aux habitant·es du squat, elles ont pu continuer d’exister. On avait envie de réutiliser toutes les compétences qu’on avait accumulées, notamment dans l’organisation d’événements, pour pouvoir aider et être utiles à d’autres squats. On a pu créer des complicités et des alliances avec d’autres espaces de vie et d’organisation.
Un an après l’expulsion de la Baudrière, on a voulu retourner à Montreuil et squatter une friche pour renouer avec l’envie d’avoir de nouveau des espaces d’organisation sur Montreuil. On s’est fait expulser au bout de quatre jours, mais ça a été un moment pour se retrouver et pouvoir reparler de ce qui s’était passé à la Baudrière.
Cette année, on a fait un festival à la Kunda, qui est l’un des derniers squats en Île-de-France, à Vitry. Un énorme squat d’habitation et d’organisation politique, avec 70 personnes, qui risque l’expulsion en ce moment même, et qu’on doit soutenir.

P : Tu disais plus tôt que vous vous êtes formé·es sur l’électricité, le son, la cuisine collective, etc. Les squats, c’est aussi ce lieu d’auto-formation dans la vie quotidienne. Comment tu as vécu cette période, qu’est-ce qui t’en reste ? Comment vous voyez la suite à ces liens qui se sont tissés dans des moments très forts quand vous habitiez ensemble ?
E : Au début, on était 9 personnes à ouvrir le squat. Très rapidement, il y a eu des nouvelles personnes qui sont arrivées. On était environ entre 15 et 20 habitant·es en tout temps. Cette forme de vie collective amène une forme d’apprentissage, et il faut réapprendre à chaque nouvelle rencontre, à chaque nouveau·elle habitant·e pour pouvoir comprendre la manière de fonctionner de chacun·e. À la Baud, il y avait plein de personnes venant d’endroits très différents.
Les personnes avec qui je milite tous les jours, avec qui je m’organise encore, avec qui je vis ma vie, c’est encore beaucoup du monde de la Baud. Mais il y a tout un tas de personnes qui, à la fin de la Baud, ont dû faire face à beaucoup plus de difficultés en termes d’hébergement. Il faut penser l’après-squat en prenant en compte les questions de solidarité, notamment avec des colocs solidaires, de l’aide mutuelle, la collectivisation du taf5 et de l’argent. C’est un moyen de garder ces liens-là. Mais ça demande quand même beaucoup de temps et d’énergie. À la Baudrière, on se retrouvait tous les soirs dans la cuisine, mais à plein de moments dans la journée on avait des vies tout à fait différentes. Il y avait des gens qui ne pouvaient pas sortir de la Baud parce que le simple fait d’être dans la rue c’était une violence en soi. Avec certain·es, on allait tous les midis à la cantine du quartier, et après on allait en manif. Quand t’habites plus ensemble, ces liens peuvent disparaitre facilement, et c’est aussi pour ça que c’était autant important de défendre cet espace-là.
Tous ces liens ont pu exister notamment grâce à l’espace du squat et à la mutualisation commune au sein de celui-ci. Mais je pense que c’est essentiel de les construire aussi aujourd’hui en dehors de ces réseaux de squats, maintenant que ces occupations n’existent presque plus. Comme à Montréal, où ça fait un moment que ça n’a pas existé. Déjà, faire exister ces types de mutualisation au sein de nos groupes affinitaires, ça permet d’avoir des ressources et des bases communes pour ensuite pouvoir les élargir.
LR : Les squats ça n’a jamais été trop un truc à Montréal mais, à une époque, il y avait quand même une tradition des appartements mis en commun, des collectifs dans Hochelaga, Villeray, etc. Je pense notamment au Funérarium, qui avait été starté par des personnes queer et trans politisées qui avaient été à la rue. Je sais que c’était un lieu très important pour certaines communautés, pour tout ce qui relevait de l’autonomie médicale, du partage de ressources. Ça reste très affinitaire, mais on voit de plus en plus surgir des permanences et des espaces ouverts. À Montréal, le TRAPS, qui est un réseau transféministe, organisent les Teatime qui sont des événements en mixité transféministe, transféminine, et qui sont ouverts assez largement, en tant qu’espaces sociaux. En créant des liens, en offrant cet espace-là, où les gens peuvent venir régulièrement, on s’assure que celleux qui sont isolés ou qui n’ont pas de réseaux de soutien puissent faire partie des communautés.
Il y a beaucoup de personnes inconnues de nos réseaux, et ce sont souvent les plus vulnérabilisées. Avec l’offensive transphobe, les premières cibles, quand on vient nous retirer des droits et l’accès médical, ce sont les personnes qui ne sont pas forcément dans nos réseaux parce qu’iels sont trop jeunes, parce qu’iels viennent d’arriver, parce qu’iels sont isolé·es autrement. J’ai été inspirée en France par des groupes qui font des permanences d’autosupport, c’est un truc qu’on gagnerait beaucoup à mettre en place aussi à Montréal, parce que nos réseaux restent très affinitaires.
P : La Baudrière c’était un espace d’organisation et de support mutuel pour des personnes TPG. Vous étiez également engagé·es dans les luttes écologiques. C’était quoi pour vous l’écologie politique, et comment avez-vous essayé de développer une écologie plus populaire, antiraciste et TransPédéGouine ?
E : On portait une forme d’écologie radicale qui faisait le lien avec nos espaces de vie. Aux Digitales, on a cette devise : la liberté d’habiter, de s’organiser, de circuler. C’est assez large, ça prend en compte pas mal de luttes. Nous, on habitait dans la métropole, ça amène à se poser des questions comme : Qui a accès à une vie digne ? Qui a accès aux espaces publics ? Qui a l’argent, le temps pour des activités ? Très rapidement, à partir du territoire qu’on habite, on fait face à toutes ces questions et on s’organise concrètement. On a fait des liens avec nos communautés TransPédéGouines, mais aussi avec des collectifs antiracistes et des collectifs qui luttent contre la gentrification. Pour moi, c’est ça l’écologie politique.
P : L’adoption de la loi Kasbarian en France a mis un coup de frein à l’ouverture de squats et à l’idée de créer un réseau de subsistance en ville. Il y a donc une tentation plus présente, chez les militant·es, de se tourner vers la campagne et d’abandonner les métropoles. Comment vous vivez cette tension ?
E : C’est drôle, parce que je pense que théoriquement, on n’a pas changé notre point de vue là-dessus : au début de la Baud, on portait clairement l’envie de rester dans les espaces urbains, parce que pour les personnes TPG, l’espace de la ville est un espace de rencontre, d’émancipation. Pour nous, c’était important de ne pas abandonner ces espaces-là. Pour autant, après des moments de répression fortes et les expulsions des squats en Île-de-France, on s’est quand même dit qu’avoir des lieux de repli, des ressources sur le long-terme, c’est quand même primordial. On a commencé à monter un projet de lieu de vie et d’organisation à la campagne, en Bretagne, dans un moulin dans lequel on a envie de pouvoir porter toutes les questions d’autonomie queer qu’on a pu faire exister en ville.
LR : Je pense que c’est intéressant ce que tu décris quand tu parles de la situation actuelle, parce qu’une tendance similaire a suivi la grève de 2015 au Québec. Sans vouloir caricaturer, toute une génération de militant·es a décidé de mettre la priorité sur la vie intentionnelle, le vivre ensemble collectif et intentionnellement politique. Pour beaucoup de gens, c’était impossible à porter en ville, et il y a eu un exode vers la ruralité.
Après la pandémie, la créativité a refait surface en ville. La question était de savoir comment est-ce qu’on peut avoir accès à des espaces qui existent déjà, comment les investir politiquement, comment est-ce qu’on peut réussir à monter des espaces pérennisés ? On a vu l’Achoppe reprendre vie à ce moment-là, se restructurer, le bar Milton-Parc [BMP] a été ouvert, puis les genstes ont investi le bâtiment anarchiste de la librairie l’Insoumise pour créer les Révoltes. Cette question des espaces en ville, elle est redevenue centrale et on a l’avantage d’avoir des sources de financement pour les mettre en place.
P : Je me demande comment faire, une fois sorti·es des espaces de squats d’organisation politique, pour que ça ne devienne pas seulement des alternatives dépolitisées. Comment rester dans une ligne de rupture et demeurer dans la confrontation vis à vis de l’état et du marché tout en étant accessibles ? Comment vous vous inscrivez dans la possibilité de faire vivre des bases arrière politiques TransPédéGouine en ruralité ?
E : Il y a eu des éditions des Digitales un peu partout en Île-de-France, et on jongle avec l’idée d’en faire une au moulin. On réfléchit beaucoup à ce terme d’accessibilité. Aller à la campagne et reprendre le moulin, c’est avoir un espace où on puisse faire vivre toutes nos mémoires et toutes nos pratiques. Ça permet de continuer à les faire vivre tout en faisant lien avec les villes autour de nous, et avec Paris, puisque c’est là aussi qu’existe encore des affinités.
C’est uniquement sur le temps long qu’on va comprendre l’espace dans lequel on atterrit. En Bretagne, il y a une énorme culture queer rurale, et il faut adopter une forme d’humilité, ne pas arriver en position de sachant·es. Plein de réseaux souterrains, de réseaux de sociabilité queer et militante existent dans ces ruralités et c’est avec de la patience qu’on va pouvoir faire des liens avec le territoire.
LR : Ça me fait penser à Trois-Pistoles, où on a assisté à la création du Récif, qui était une ancienne auberge où les genstes venaient crécher quand iels étaient en route vers la Gaspésie, et qui a été rachetée par des camarades. Aujourd’hui, il s’est créé une communauté autour, et on dit à la blague que c’est la ville avec le plus d’anarchistes et le plus de queer par habitant·es.
P : Pendant la présentation des Digitales que tu as donnée avec le FLIP, tu disais qu’il y avait un enjeu à « re-politiser les pédales » et ça m’a fait penser au Village, à Montréal, qui était un lieu de lutte à la base, mais qui est devenu un centre gentrifié et libéral. Est-ce qu’il y a le même enjeu à « repolitiser les campagnes » en créant de nouveaux réseaux militants dans les territoires ruraux ?
E : Moi, je crois en la propagande par les faits. Montrer qu’on peut faire exister des enjeux de solidarité, des enjeux d’autonomisation, de communisation matérielle, ça va donner envie à plein de genstes d’avoir les mêmes pratiques. Que ça soit en ville ou à la campagne pour moi ça reste la même logique de l’autonomie.
Si la question du milieu LGBT s’institutionnalise, c’est qu’à plein d’endroits (sociaux ou géographiques), on n’a pas du tout les mêmes intérêts. Bien sûr, quand tu es gay dans le quartier du Marais, t’as pas intérêt à devenir anarchiste. Ça impliquerait que tu te précarises de ouf, et que tu fasses face à une répression hyper forte. Quand t’es un mec cis, blanc, gay ou une meuf cis, blanche, lesbienne et que t’as plein de droits acquis, celui d’avoir des enfants, de te marier, à quels moment tes intérêts c’est de faire face au pouvoir ? Tu deviens matériellement moins intéressé·e par la question révolutionnaire.
C’est aussi à nous de réaffirmer que ces droits-là, ils sont pas acquis, de parler de nos mémoires, de nos histoires, d’où on vient. C’est important et c’est un moyen de re-politiser les communautés queer.
LR : Ça nous ramène à la question des espaces selon moi. Le village est contrôlé par la bourgeoisie gay et les propriétaires, mais il existe des espaces, à Hochelaga, à Villeray, où les communautés queers, trans, lesbiennes sont en réseaux. Mais si tu sors du placard, que tu viens pas de Montréal, et que tu débarques, c’est pas dans ces espaces-là, dans ces réseaux-là que tu arrives en premier lieu. Tu vas débarquer dans le Marais, dans le Village, dans des espaces gays dépolitisés. C’est pour ça que c’est crucial d’avoir des espaces publiquement militants et queers. Ça permet à des gens de rejoindre les espaces politiques queer, non pas parce que c’était leur intérêt premier, mais parce qu’il y a des espaces où la politique et la communauté coexistent.
E : On a vu à quel point la communauté queer a pu s’embourgeoiser, s’institutionnaliser, donc il faut faire attention parce qu’on devient très vite récupérable, que ce soit par le marché, l’état ou même le fascisme. On est très facilement réutilisable par ces institutions qui vont souvent attaquer en premier lieu les personnes racisées. Je pense que ce sont des questions vraiment prioritaires, et notre combat doit dépasser nos identités seules pour créer des solidarités avec d’autres communautés, que ça reste imbriqué dans une lutte antifasciste globale.
LR : Ça fait rêver, les squats queer en Europe, et on envoie notre soutien et notre solidarité à toustes celleux qui ouvrent et qui défendent ces lieux. Je pense que la situation en France ressemble de plus en plus à celle au Québec donc on a d’autant plus intérêt à se parler pour échanger des moyens et des stratégies à employer dans nos luttes pour atteindre des autonomies queers.
[1] Le FLIP, Front de lutte pour un immobilier populaire, s’organise sur un ensemble d’enjeux comme les hausses de loyers et pour reprendre le contrôle sur la partie immobilière, pour la collectiviser C’est un collectif qui a été traversé par l’imaginaire du squat européen et qui a repris un imaginaire et un historique ici, depuis le dernier squat d’organisation politique de Préfontaine de 2001.
[2] Quartier populaire de Paris en voie de gentrification.
[3] Lieu de vie, d’hébergement, d’activités, squatté fin mai, début juin 2021. Le collectif accueille en son sein des membres de la communauté LGBT, des artistes, artisans, travailleur-ses précaires, gilets jaunes, demandeur-ses d’asile rescapé-es de zones actuellement en guerre.
[4] [Eviction, film de Mathilde Capone, 2023]
[5] Travail en argot.