Les médias complices du racisme et de la violence policière : Une analyse discursive
Que la voix d’un ex-enquêteur de police à la retraite pèse plus dans la balance que les multiples témoignages de celleux ayant assisté à la tragédie s’explique par la valeur inégale accordée aux différentes prises de parol
Par Nuage
La police et les prisons sont des institutions violentes et racistes, issues d'un héritage colonial qui ne servent qu'à reproduire les injustices du système capitaliste. Tous les jours, même quand c’est la soi-disant paix sociale, la police violente, harcèle et incarcère les personnes les plus démunies et les plus opprimées. Et quand elles se soulèvent, c’est encore la police et la prison […] Il peut être difficile d'y voir clair à travers la supposée neutralité du système juridique et les discours de légitimation de la police. Comment faire la part entre bavures individuelles et discriminations institutionnalisées ? Qu'est-ce qui explique la sur-représentation de certains groupes dans les prisons ? Comment ces structures nous mettent à mal en prétendant vouloir nous protéger et nous servir ? Comment la catégorie de "criminel" est-elle construite? Ne sert-elle pas seulement à nous faire avoir peur les unes et les uns des autres ? – Coalition des luttes anti-capitalistes (CLAC), 2021
Durant la fin de semaine du 29-30 mars 2025, le SPVM a fait deux morts, et le SPVQ, une de plus. Une personne est tuée par balle. Une succombe à ses blessures après avoir été brutalisée par la police. Une autre meurt en détention aux mains du SPVQ (BEI, 2025a-d; Popovic, 2025; Front Rose, 2025a). Nous n’avons, malheureusement, toujours pas d’informations sur la personne morte en détention, mais notons que les deux personnes tuées par le SPVM en moins de 12 heures (Front Rose, 2025a) sont des hommes racisés : A et Abisay Cruz (nous ne nommons pas la première victime par respect pour la famille qui, au moment de la rédaction, souhaitait garder le silence). Face non seulement à ces tragédies, mais aussi à la banalisation et au silence des médias et des politiciens, la rage des communautés concernées et des personnes solidaires se voit ravivée : comprenez qu’elles n’en sont pas à leur premier deuil, et que ce n’est pas non plus la première fois que leur souffrance est minimisée, voire niée complètement, par le discours public. Rappelons-nous, en 2020, la vague de manifestations ayant suivi l’assassinat de George Floyd, mais aussi comment « l’appareil politique et médiatique libéral [s’était mis] en marche pour pacifier le mouvement [prétendant] que des efforts [seraient] faits pour se pencher sur la question des violences policières » (Louve Rose, 2025).
À cet égard, la situation actuelle n’est pas très différente. La semaine dernière, nous écrivions qu’
Alors que les médias sociaux débordent d’images montrant le harcèlement, la violence et l’intimidation exercées par le SPVM et les constables de la STM, les médias choisissent de prendre le parti des interventions policières — ou, plus simplement, de ne plus vouloir en parler. Le conseil municipal augmente le budget du SPVM à hauteur de 40 millions et met en place des règlements pour faciliter le harcèlement et la répression des communautés itinérantes. Les manifestations pour la Palestine, les droits trans, les luttes syndicales, ou n’importe quels autres sujets qui dérangent le pouvoir, sont de plus en plus violemment réprimésUne telle couverture médiatique est inacceptable — voire dangereuse — et il est important de la déboulonner par une analyse discursive rigoureuse afin de mettre en évidence le racisme systémique du corps policier, son expression dans l’espace médiatique et le rôle instrumental qu’il joue dans le maintien à la fois du pouvoir et de l’impunité de la police.
Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI); ni indépendant, ni impartial
Dans les communications du Bureau des enquêtes indépendantes, la description des circonstances des décès causés par la police est au mieux laconique. Le ton est factuel. Aucun enjeu n’est soulevé explicitement. À aucun endroit, il n’est question de violence policière — d’ailleurs, ni le mot violence ni le mot brutalité n’y apparaissent — alors que les noms des victimes sont passés sous silence et ceux des policiers qui les ont tuées sont passés sous silence.
Le BEI se dit indépendant, transparent et impartial. C’est d’ailleurs cette posture qu’il essaie de renforcer avec son usage d’une forme neutre et factuelle — un langage dont il se sert pour dissimuler ses aprioris sous couvert d’une supposée neutralité. Rappelons que le BEI a été créé en 2013, suite à l’enquête publique du coroner sur la mort de Fredy Villanueva — enquête qui décriait la partialité et les conflits d’intérêts flagrants impliquant les enquêteurs de la Sureté du Québec (SQ) chargés du dossier. Or, ironiquement, cette nouvelle instance a les mêmes failles, puisque plusieurs enquêteurs du BEI sont aussi d’anciens policiers. « Les enquêtes de la police sur la police continuent », en conclut Lynda Kheli dans un article de Léa Beaulieu-Kratchanov (2025). S’il fallait donner des preuves statistiques de cette impartialité illusoire, notons que, depuis sa création, seulement 2 des 446 enquêtes (au moment de la rédaction) se sont soldées par des procédures judiciaires (BEI, 2025e).
Dans ses communications, le BEI omet aussi de préciser que les informations présentées sont uniquement celles fournies par les policiers concernés. L’article de Pivot, signé par Léa Beaulieu-Kratchanov, explique qu’il s’agit d’un problème majeur :
la première version de l’histoire révélée au public est souvent la plus persistante. Elle tend à éclipser d’autres versions, souvent contradictoires, provenant des familles et d’autres témoins. «Ce que ça fait, c’est que les médias vont largement reprendre ces informations en disant que c’est le BEI qui les déclare. Et donc, quand les gens associent à tort le BEI à de l’indépendance, le narratif devient ancré.La méthodologie du BEI et du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a conséquemment été largement critiquée par des groupes comme la Ligue des Droits et Libertés (LDL) et la Coalition contre la Répression et les Abus Policiers (CRAP). Ces-derniers dénoncent, dans un rapport conjoint publié en 2020, la sous-culture du silence et l’omerta policière – ou la solidarité bleue – qui indemnise les policiers à travers le BEI et le DPCP.
Le perroquetage des médias de masse
Trahissant leur rôle de quatrième pouvoir, les articles parus dans les médias ne font que relayer les déclarations du BEI sans distance critique — du moins avant que les mobilisations citoyennes ne leur forcent la main. Sans surprise, quand on passe leur rhétorique à la loupe, on retrouve les tactiques habituelles de banalisation, d’euphémisation et de culpabilisation des victimes. Le 30 avril au soir paraissait, par exemple, un article de la CBC qui couvrait brièvement les annonces d’enquêtes annoncées par le BEI : « BEI launches 2 investigations into Montreal police over the weekend ». L’article, comme ceux des autres médias généralistes, ne rapporte que des informations tirées des communiqués du BEI. On y fait usage d’un langage passif pour présenter la mort des victimes. « [Police] intervention that resulted in death », peut-on y lire. Dans cette formule, une personne meurt. Or, personne (encore moins la police) ne la tue. Les interventions policières sont désignées par des euphémismes : « they « made contact » with the individual », « a physical altercation occurred between the man and police officers ». Les interventions sont présentées comme une simple fatalité : « After that, the officers allegedly restrained the man, who then suffered from a « malaise » and lost consciousness ».
Comme Alexandre Popovic dans un article publié sur Pivot, il faut également décrier fermement l’absence de détails quant aux actions posées par la police :
Aucun détail sur les gestes posés par les flics durant l’intervention. La personne a simplement perdu connaissance après avoir été « maîtrisée », un euphémisme qui cache souvent de la brutalité policière. […] Voilà qui ne va pas sans rappeler le choix de mots utilisés dans le communiqué du BEI sur l’intervention du SPVM qui a couté la vie à Koray Kevin Celik, 28 ans, à L’Île-Bizard, le 6 mars 2017. Là aussi, le BEI parlait d’une personne « en crise » que les flics ont voulu « maîtriser » avant de constater une perte de conscience, puis un arrêt cardio-respiratoire. À aucun endroit il n’est fait mention de la force utilisée par le SPVM. Comme si la mort subite d’un jeune homme dans la force de l’âge allait de soi.Notons aussi la stratégie de la CBC de ne relayer que certains détails quant à la nature des interventions : le meurtre de A serait survenu dans le contexte d’une réponse à un appel au 911 au sujet d’une personne armée à l’intérieur d’un complexe d’appartements, et celui d’Abisay Cruz, en réponse à un appel au 911 au sujet d’une personne en crise. La mention de l’état de crise d’Abisay ouvre, sans considération, la porte à des justifications psychophobes. En l’absence d’autres informations sur le déroulement des interventions, ces détails ont pour effet, voire pour objectif, de laisser libre cours à une légitimation de la violence policière. Ils sous-entendent que les personnes interpellées étaient dangereuses et laissent donc entendre que le traitement brutal qui leur a été infligé était justifié.
Popovic n’est pas dupe de cette rhétorique et la commente ainsi :
Bien sûr, la présence de l’arme à feu viendra justifier aux yeux de plusieurs le recours à la force mortelle. Je crois néanmoins que les tirs policiers méritent d’être remis en question. […] Je m’oppose également farouchement à l’idée, aussi facile que fataliste, voulant que les décès aux mains de la police soient aussi inévitables que la neige durant l’hiver québécois. […] Chaque nouvelle vie perdue aux mains de la police représente une nouvelle occasion manquée d’appliquer des méthodes non violentes de désescalade qui ont pourtant fait leurs preuves.Les autres médias traitant l’affaire vont emboiter le pas. Lorsque CTV News couvre l’enquête du BEI sur la mort de A dans une courte vidéo, la chaîne rapporte essentiellement les mêmes propos que l’article de la CBC. Leur titre, « Man shot and killed during police investigation, BEI investigating », est cependant plus sensationnaliste, moins passif, mais ne mentionne, néanmoins, toujours aucun enjeu relatif à la violence policière. Lorsque Le Journal de Montréal, via l’agence QMI[1], couvre la mort d’Abisay Cruz (sans jamais le nommer), il ne cite que le rapport du BEI et fait référence à « une intervention impliquant des policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), dimanche matin, au cours de laquelle un individu est décédé ». Dans cette forme passive, ce ne sont pas des policiers qui ont tué un individu, mais une intervention qui a causé un décès. Les événements ayant précédé ou causé le décès en question sont décrits très brièvement.
Le conditionnel déontologique utilisé par le BEI pour témoigner du fait que l’enquête est encore en cours déborde le contexte du communiqué s’étend au contenu éditorial du journal, renforçant ainsi le doute quant à la culpabilité policière :
Selon les premières informations, le SPVM aurait été appelé à se rendre à l’arrière d’une résidence, vers 8h06, concernant une personne en crise. Quelques minutes plus tard, les policiers seraient entrés en contact avec la personne. «II y aurait eu une altercation physique entre les policiers et la personne et les policiers auraient maîtrisé la personne [...] La personne aurait alors subi un malaise et une perte de conscience», a indiqué le BEI dans un communiqué, dimanche soir. La personne aurait été transportée dans un centre hospitalier où son décès a été constaté.La seule chose que le JDM n’ose pas mettre au conditionnel, c’est le constat du décès de la victime.
Les mobilisations sont oubliées, pacifiées, dépolitisées ou réprimées
Cette tendance va s’étendre à la manière dont sont couvertes les diverses mobilisations engendrées par ces drames. Le 1er avril, Le Journal de Montréal publie un article sur la première mobilisation, une marche dont l’appel est lancé par les proches d’Abisay. Malgré la forte présence policière et la violente répression subie par les manifestant·es, aucun commentaire ne porte sur la violence que constitue, pour les proches d’Abisay et les communautés locales, le fait d’être entouré·es de polices alors que le défunt qu’iels pleurent est mort aux mains de cette-dernière.
L’accent est plutôt mis sur une vision pacifiée de la douleur des proches et de la solidarité exprimée par les habitant·es du quartier. La vidéo au début de l’article montre, par exemple, des extraits qui renvoient une image pacifiée de l’événement. On y voit et entend de la musique, des gens qui dansent, quelques slogans sur des affiches et des fleurs laissées au sol. L’article diminue également la taille estimée du rassemblement en parlant de « dizaines de personnes », alors qu’il y en avait des centaines (Front Rose, 2025b). Enfin, le texte ne mentionne qu’au passage la haute surveillance policière exercée lors de la soirée, alors que nous savons que l’intervention policière y a largement dépassé la simple surveillance :
La manifestation, qui alternait entre des périodes de deuil et de rage, s’est déroulée sous la surveillance d’un lourd dispositif policier. Très rapidement, le SPVM a essayé, sans succès — il faut le souligner — d’interdire à la manifestation de prendre le boulevard Pie-IX. Or, en peu de temps, les manifestant·es ont réussi à bloquer l’artère et à rejoindre le poste de quartier 30 du SPVM, au croisement de la 40e avenue. La colère des manifestant·es, combinée aux tentatives d’intimidation du service de police, a rapidement fait monter le ton. Alors que la foule retournait vers le point de départ, la police s’est vue tenue en respect par des tirs de projectiles, ainsi que par le courage et l’impressionnante détermination des manifestant·es. À plusieurs reprises, les policier·ères ont dû abandonner leurs positions. Alors qu’une vigile commençait, des feux d’artifice ont été allumés en l’honneur d’Abisay. Un petit feu a également été allumé dans la rue par des manifestant·es. Le service anti-émeute a alors essayé d’intervenir violemment, notamment en tirant des bombes lacrymogènes sur la vigile. Les lignes d’anti-émeute ont tout de même dû battre rapidement en retraite sous les projectiles et la ligne de manifestant·es qui avançait vers elles.Le langage passif et évasif combiné à l’usage insistant de termes comme « en crise » — qui déplacent la responsabilité sur l’état de la victime — écarte une fois de plus toute mise en cause possible de la police : « un homme décédé durant une intervention policière, alors qu’il était en crise […] Le vingtenaire, en crise, a d’abord eu une altercation physique avec les policiers. Il a ensuite subi un malaise et une perte de conscience. Son décès a finalement été constaté à l’hôpital ». Or, selon les témoignages des voisin·es et témoins que l’on a pu recueillir sur le terrain, ainsi que les preuves vidéo qui ont circulé et les témoignages rapportés dans des médias alternatifs, il aurait été plus juste de dire qu’Abisay a été tué par la police d’une façon brutale. Que la police l’a rué de coups. Qu’elle a frappé sa tête contre le sol. Qu’elle l’a écrasé au sol de manière prolongée en entravant sa respiration, et qu’elle a ensuite trainé son corps inanimé, le ventre au sol.
Des enjeux d’injustice épistémique et de racisme systémique
Ces versions existent et elles ont circulé. Mais les médias choisissent de les ignorer, et quand ils daignent leur donner une place dans leur couverture, c’est souvent pour les discréditer. Par exemple, on peut, effectivement, apprécier que l’article publié par le Journal de Montréal relaie la parole d’une voisine ayant participé à la marche de mardi soir, ainsi que celle des proches d’Abisay qui dénoncent les négligences et violences policières. Mais l’absence délibérée des vidéos — pourtant largement diffusées et documentant une partie des interventions violentes de la police — contribue à faire passer ces témoignages pour anecdotiques ou infondés. Les journalistes présentent donc les paroles des témoins sans réunir les conditions nécessaires pour construire leur crédibilité aux yeux du public.
Comme l’explique le sociologue Pierre Bourdieu, que la parole soit honnête, précise, creuse ou incompréhensible, il importe avant tout qu’elle soit prononcée dans un contexte légitime par une personne reconnue et habilitée à produire cette parole. […] Les personnes dans des positions sociales subordonnées ou subalternes se voient, par définition, nier la reconnaissance autorisant et valorisant leur parole dans l’espace public. […] Les formes élémentaires de la censure traduisent les rapports de pouvoir qui structurent nos sociétés. Tout comme la prise de parole, la capacité de censurer est inégalement distribuée. Les codes et les conventions qui régulent le débat public sont principalement définis par les dominants—qui jouissent d’un quasi-monopole de la parole légitime—et contribuent à la reproduction de l’ordre social. Il en va de même des instances qui ont le pouvoir formel d’autoriser ou d’interdire la parole. L’article n’en fait définitivement pas assez pour rétablir la justice épistémique nécessaire à la légitimation de ces voix, qui seront, on peut s’y attendre, systémiquement délégitimées en raison du racisme et du classisme dont elles sont la cible. Rien, dans ce texte, ne vient s’opposer à l’autorité prépondérante attribuée aux paroles des policiers véhiculées via les déclarations du BEI.
L‘un des exemples les plus criants de ce déséquilibre dans le partage de la légitimité est sans doute l’entrevue accordée le dimanche 6 avril au Journal de Montréal par l’ex-enquêteur du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), Roger Ferland. Titré « Mort d’Abisay Cruz: le travail des policiers ne devrait pas être mis en cause, selon un ex-enquêteur », l’article est rempli d’extraits où l’ex-enquêteur commente les protocoles en place et le niveau de violence utilisé.
En voici un verbatim :
l’intervention va mal tourner, l’homme a perdu la vie après l’altercation avec les policiers […] la personne a un profond désorganisement quelconque […] les policiers ont dû faire usage de la force de la maitriser […] la personne finalement serait décédée des suites de la maitrise, c’est effectivement des situations qui peuvent souvent se produire, face à des cas de délirium agité […] il faut le faire [immobiliser la personne] pour l’amener à recevoir des soins […] [le niveau de force utilisé] c'est toujours une question de jugement, en fait, de perception de la part du policier, à savoir qu'est-ce que lui estime qu'il a besoin de faire dans de pareilles circonstances […] mais on va en savoir beaucoup plus plus tard, est-ce qu’elle était intoxiquée par l’alcool, la drogue ou d’autres phénomènes. C’est pour ça qu’il faut être calme en ce moment. […] Le BEI va faire la lumière sur tout ça […] pis je continuerais de faire confiance aux policiers. […] les policiers qui travaillaient dans ce secteur là c’est des gens surement qui apprécient cette clientèle là, qui sont là avec les gens du quartier, c’est pas des jeunes policiersCe dernier passage — « les policiers qui travaillaient dans ce secteur là c’est des gens surement qui apprécient cette clientèle là, qui sont là avec les gens du quartier » — relève de l’opinion. Une opinion erronée qui tente de détourner l’attention de l’éléphant dans la pièce — celui qui, pourtant, n’a toujours pas été nommé — à savoir, le racisme systémique dont la police est un agent. Plusieurs proches d’Abisay connaissaient Fredy Villanueva… et ce souvenir ravive des blessures profondes, pour lesquelles il n’y a jamais eu réparation. Et c’est sans compter la surveillance, les interpellations et les altercations quotidiennes que subissent les résident·es dans ces quartiers lourdement policés. Comme on l’écrivant récemment : « Plusieurs résident·es du quartier nous ont mentionné que les policiers impliqués étaient connus du quartier et avaient un historique de violence et de harcèlement. » (Front Rose, 2025c).
Suite à une demande envoyée au journal, un correctif (sans notice) sera apporté concernant la mention du « délirium agité », condition pseudo-scientifique largement supportée par une compagnie qui produit des armes utilisées par la police :
The term "excited delirium" dates back decades but has never been supported by rigorous scientific studies. Still, the term persisted as some of its early researchers earned money for testifying as expert witnesses in cases involving law enforcement and the company now called Axon Enterprises, which makes the Taser stun gun.The theory suggested that agitated, delirious individuals were dying not because they had been shocked by stun guns, restrained with chokeholds, or held facedown so they couldn't breathe, but because of this unexplained medical condition that could lead to sudden death.Funding from Taser International, Axon's former company name, sponsored some of the research forming the basis of ACEP's white paper supporting the excited delirium theory, according to a 2017 Reuters investigation. The 19-person task force that drafted the 2009 paper included three people who provided paid testimony or performed consulting work for Taser, that report found. KFF Health News called eight of the task force members but none agreed to interviews. Axon executives did not respond to calls or emails seeking comment on the white paper. Si ces références disparaissent des citations rapportées dans le texte, ce changement ne sera jamais commenté — tandis que les propos continueront d’exister dans la vidéo de l’entrevue. Ce pseudo-diagnostic, ainsi que le reste du vocabulaire employé, les tournures de phrases utilisées et leur contenu; tout, dans cette entrevue, travaille à faire paraître nécessaire, inévitable et légitime la violence policière. La mention, même sous la forme interrogative, d’une potentielle consommation de drogues et d’alcool déplace la responsabilité vers la victime, et ce sur la base d’une éventualité hypothétique qui ne devrait de toute façon pas justifier la violence subie[2]. Ce que l’ex-enquêteur nous dit entre les lignes c’est la police peut arbitrairement juger à quel moment elle se permettre de tuer pour exercer son travail. Et ce, en toute impunité. On retrouve dans cette entrevue la même rhétorique que celle employée dans les articles cités plus haut. Or, cette fois, le discours est porté par une personne en situation d’autorité — une personne dont l’opinion est sur-légitimée, et dont les propos ne font que reconduire les discours déjà dominants. En donnant un visage et un nom (d’homme blanc aisé) à ce discours, l’entrevue participe à faire pencher l’opinion publique en faveur de l’indemnité policière, continuant d’écraser les voix des communautés concernées et consolidant le pouvoir dominant et l’ordre social oppressif.
Que la voix d’un ex-enquêteur de police à la retraite pèse plus dans la balance que les multiples témoignages de celles et ceux ayant assisté à la tragédie s’explique par la valeur inégale accordée aux différentes prises de parole. Une valeur ici érigée sur la position sociale et le statut racial de chaque intervenant·e. Que l’article ne fasse aucunement mention des enjeux raciaux qui traversent ce drame n’est pas surprenant, mais ne devrait pas nous empêcher d’examiner en quoi ce choix participe aussi d’une forme de censure. Car on ne censure pas seulement en retirant la parole. On censure aussi en n’offrant pas — voire, parfois, en retirant — à certaines personnes ou à certains groupes opprimés les conditions nécessaires pour la prendre dans un cadre sécuritaire qui leur permettrait d’être entendues. D’être crues.
[La] censure revancharde peut aussi s’exercer par le fait d’associer la personne ayant pris la parole à un groupe stigmatisé. Le discrédit dont souffre ce groupe est alors transféré à cette personne. Une telle stigmatisation peut décourager certaines identifications—on évitera, par exemple, de s’affirmer publiquement comme féministe ou musulmane pour éviter le stigma qui affecte ces catégories—et, ainsi, contribuer à rendre plus vulnérables les personnes ayant pris la parole et favoriser des divisions au sein de certaines communautés .Faire intervenir des voix systématiquement délégitimées sans faire le travail politique de les restituer est au mieux un travail bâclé, sinon une forme de lâcheté aveugle, incapable de reconnaitre son propre pouvoir, ses propres responsabilités. Ceci explique notamment la réticence de certaines personnes à témoigner ou à révéler des informations. Ces personnes craignent, à raison, que ces informations puissent être utilisées non pas pour permettre d’éclaircir la situation, mais plutôt pour consolider des récits préjudiciables et racistes. C’est une crainte que les proches sont contraint·es de garder constamment à l’esprit.
La première victime de la police, A, est un homme noir. Il y a de nombreuses motivations possibles pour taire un nom, que ce soit dans l’espoir de faire son deuil en paix, d’éviter le traitement discursif violent infligé aux victimes et aux proches par les médias de masse, ou d’éviter des représailles. Mais il est difficile de ne pas se demander si le choix fait par la famille de A (ne pas révéler son nom et son visage) témoigne d’une forme d’auto-censure sournoise. Révéler l’identité de A aux médias peut contribuer à dénoncer le racisme systémique dont la police est un agent, mais cette information, entre les mains des médias, pourrait être utilisée pour essayer de confirmer des stéréotypes racistes qui légitiment encore une fois la violence policière. Les médias de masse ont après tout tenté d’entacher l’image de la seconde victime, Abisay Cruz, un homme latino, père de famille, âgé de 29 ans. La fin de l’article du Journal de Montréal couvrant la première mobilisation suivant son meurtre est des plus violentes : « Cruz, père d’un enfant de neuf ans, avait plusieurs antécédents criminels. Il a notamment plaidé coupable à des accusations de trafic de stupéfiants, de voies de fait à deux reprises et même pour bris de condition ». En mentionnant ses antécédents, les médias légitiment, encore une fois, l’usage de la violence par la police tout en insistant sur une vision stéréotypée, classiste et raciste des communautés défavorisées et/ou racisées issues, notamment, des quartiers Saint-Léonard, Saint-Michel et Montréal-Nord.
Maryse Potvin, experte en éducation antiraciste, en parle dans l’introduction de son article « The Reasonable Accommodations Crisis in Quebec: Racializing Rhetorical Devices in Media and Social Discourse » :
In pluralist societies, media coverage of issues related to minorities and ethnic relations too often perpetuates certain biases that can fuel stereotypes, prejudices, and “racist slips” in the public expression of opinions. Even with careful attention to objectivity, the media sometimes transform public debates over ethnic or religious issues into “societal crises” that can contribute to a state of “moral panic”among the population.Nommer et mettre de l’avant les antécédents criminels d’Abisay Cruz est un choix politique. En discutant avec les proches d’Abisay et les résident·es du quartier, nous avons eu accès des récits qui en proposent une image différente — souvent absente du traitement médiatique. Les sources sont là. C’est une décision de ne pas les mobiliser. C’est un choix aussi (et un choix odieux) de mentionner le fait qu’Abisay Cruz était père d’un jeune enfant (ce qui l’humanise à juste titre) en accolant cette information à la mention de ses antécédents judiciaires, laissant implicitement croire qu’il aurait pu être un mauvais père ou même une menace pour son fils.
En relayant les déclarations du BEI et en partageant l’idéologie pro-police qu’elle défend, les médias reconduisent l’injustice épistémique initiale par laquelle la police étouffe dans ses rapports la voix des autres témoins. Ensemble, ces deux instances finissent par constituer et alimenter un système de sens imprégné de biais, de préjugés et de stéréotypes issus des oppressions systémiques — notamment celles liées à la race et à la classe — et qui contribuent au maintien du pouvoir entre les mains dominantes… et entre les pattes de leurs chiens de garde : la police…
Le dimanche 6 avril, deux autres manifestations se sont déroulées sur l’Ile de Montréal. Une dans le même quartier où Abisay avait été tué une semaine plus tôt[3], et une autre au centre-ville[4]. Encore une fois, les médias généralistes ont occulté les violences commises par la police pendant ces deux manifestations. Voici les paroles rapportées d’une porte-parole du SPVM, Caroline Chèvrefils, au sujet de la manifestation dans Saint-Michel : « police arrested six people — four for armed assault against an officer and two for assault also against an officer. She says nobody was injured » (Yanez-Leyton, 2025). D’abord, rappelons que la police a fait des blessé·es lors de ces deux événements[5].Si ces blessures n’ont pas été déclarées, c’est (surement) parce que les personnes victimes ont préféré se faire soigner par leurs camarades. Les policiers savent bien qu’ils ont causé des blessures; plusieurs prennent vraisemblablement plaisir à en infliger.
Notons, d’autre part, les habituelles tentatives de divisions entre les « casseurs » et les autres manifestant·es :
Malheureusement, il y a des casseurs qui se sont invités dans une marche pacifique. Ils ont commis des agressions armées contre des policiers. [...] À un moment, ils ont lancé des projectiles et des bombes fumigènes vers l'autoroute Métropolitaine. Nos policiers sont intervenus, a précisé l'inspecteur-chef David Shane, chef des communications au SPVM. […] Le SPVM aimerait faire un appel au calme dans la situation qu'on vit actuellement dans Saint-Michel. On comprend qu'après un événement pareil, il y a un questionnement de la population et de la famille. Manifester est un droit fondamental. Mais il faut le faire dans le respect des règles et des lois. Une citation de David Shane, inspecteur-chef et chef des communications du SPVM.En comparant les affirmations de la police relayées par les médias de masse avec les vidéos et comptes-rendus publiés par les médias alternatifs, on voit que ces derniers arrivent nettement à démentir cette division, qui sert avant tout à pacifier les mobilisations, à garder le monopole de la violence entre les mains des flics et à renforcer le mythe des « agitateurs externes » pour nuire aux alliances qui se construisent. Des témoignages issus du terrain soutiennent que l’escalade des actions posées venait d’une diversité de manifestant·es. Si les modalités d’expression de cette colère peuvent faire l’objet de débats, la rage partagée au sein des communautés locales reste indéniable. Refuser de le reconnaître, c’est aussi leur refuser une quelconque agentivité. C’est les percevoir comme des sujets dépolitisés. C’est accepter de neutraliser l’aspect politique de cette rage.
N’oublions pas que ce sont les premier·ères concerné·es qui écopent — démesurément, et au quotidien — de la répression.
C’est aussi là une forme d’intimidation qui incite à l’auto-censure, et qu’un jeune interviewé nomme avec acuité :
Que je sois un Arabe, un Noir, ou que j’ai des tresses, que je suis habillé tout en noir, ou que je suis dans une voiture, ce n’est pas une raison pour que vous devez m’arrêter, lance un jeune du quartier Saint-Michel, qui a demandé l’anonymat par crainte d’être reconnu par les policiers de son secteur Les mobilisations finissent par porter fruit : les médias ne peuvent plus taire l’affaire
Suite aux manifestations du dimanche 6 avril, de nombreux articles couvrent non seulement les mobilisations, mais aussi les circonstances de la mort d’Abisay. Plusieurs donnent parole aux organisateur·ices des mobilisations locales (Ferah, 2025; Langlois, 2025; Yanez-Leyton, 2025; Émond et Séguin, 2025; Madoc-Jones, 2025), à des groupes de lutte contre la brutalité policière (Ferah, 2025; Yanez-Leyton, 2025) et à des experts et professionnels en sciences sociales (Yanez-Leyton, 2025; Madoc-Jones, 2025; Robidas, 2025). Plusieurs relaient aussi les motivations ou demandes derrière les mobilisations (Ferah, 2025; Yanez-Leyton, 2025; Émond et Séguin, 2025; Madoc-Jones, 2025). Certains mentionnent les témoins et les vidéos prises documentant le meurtre d’Abisay (Ferah, 2025; Yanez-Leyton, 2025; Robidas, 2025). La plupart mentionnent les autres meurtres perpétrés par la police (Yanez-Leyton, 2025; Émond et Séguin, 2025). Enfin, ils font entrer l’expression « brutalité policière » dans leur vocabulaire (Ferah, 2025; Yanez-Leyton, 2025; Robidas, 2025). Ce sont des changements majeurs et positifs lorsqu’on compare ces articles à la couverture médiatique parue jusqu’alors. Reste que ces textes portent également leur lot de violences discursives.
Entre l’ouverture des enquêtes du BEI et avant le deuxième jour de manifestations, les médias n’auront fait que perpétuer l’ordre social; présentant les paroles policières comme légitimes, taisant la voix des témoins et des proches des victimes, et mobilisant implicitement des arguments racistes pour légitimer la brutalité policière. Le deuxième jour de manifestations aura permis, en rendant le travail journalistique plus aisé — grâce à une perturbation visible et des discours articulés — de faire entendre des voix et des récits jusque-là ignorés. Reste que rien, dans les médias de masse, ne s’oppose suffisamment à la légitimité accordée aux paroles et violences policières.
Et depuis, les médias ont tourné la page. C’est pourquoi les mobilisations doivent continuer, que ce soit pour faire bouger la fenêtre d’Overton ou pour rendre la police un peu moins à l’aise de tuer. Toutefois, si on dénonce le silence, l’insuffisance irresponsable ou la complicité oppressive des médias de masse, on doit aussi mettre en garde contre la façon dont les médias indépendants de gauche — comme le notre — souvent blancs et universitaires, sont susceptibles d’instrumentaliser la mort d’Abisay en construisant avec lui une figure de martyr. Abisay Cruz n’est pas le monstre que sous-entend la police, ni le héros que pourraient y voir une frange plus mobilisée de la population. C’est un être humain et c’est à titre d’être humain qu’il est important de défendre sa mémoire, de s’insurger contre le traitement brutal que les policiers ont infligé à son corps, puis les médias à son histoire. Mais n’oublions pas que la police abuse et brutalise tous les jours. D’autres sont morts durant ce week-end sanglant. Tel que l’exigent les proches, réclamons Justice pour Abisay. Mais assumons un discours qui nomme les enjeux à leur échelle : l’institution entière doit tomber. Si le deuil appartient aux proches, si la brutalité et le désespoir touchent avant tout les communautés locales et celles des quartiers qu’on a défavorisé, la rage et la lutte concernent tout le monde. Mais nous devons savoir les mener en respectant les besoins des proches et l’agentivité des premier·ères concerné·es et, surtout, sans instrumentaliser l’horreur de cette affaire révoltante.
No justice, No peace, Abolish the police!
Références
Agence QMI. (s.d.). Notre Raison d’être. Agence QMI. http://www.agenceqmi.ca/
Agence QMI. (2025, 30 mars). Mort d’un individu en crise à Montréal: le BEI ouvre une enquête. Journal de Montreal, Actualité, Justice et faits divers. https://www.journaldemontreal.com/2025/03/30/mort-dun-homme-en-crise-a-montreal-le-bei-ouvre-une-enquete
Ancelovi, Marcos. (2017, 29 mars). Les formes élémentaires de la censure. Ricochet, Non catégorisé. https://franco.ricochet.media/2017/03/29/les-formes-elementaires-de-la-censure/
Arkat, Yahia. (2025, 7 avril). Mort d’Abisay Cruz: le travail des policiers ne devrait pas être mis en cause, selon un ex-enquêteur. Journal de Montreal, Actualité, Société. https://www.journaldemontreal.com/2025/04/07/mort-dabisay-cruz-le-travail-des-policiers-ne-devrait-pas-etre-mis-en-cause-selon-un-ex-enqueteur
Beaulieu-Kratchanov, Léa. (2025, 10 avril). De Fredy Villanueva à Abisay Cruz : la brutalité policière continue au Québec. Pivot, Reportages. https://pivot.quebec/2025/04/10/de-fredy-villanueva-a-abisay-cruz-la-brutalite-policiere-continue-au-quebec/
(BEI) Bureau des enquêtes indépendantes. (2025a, 30 mars). Le BEI annonce le déclenchement d’une enquête à Montréal le 29 mars 2025. Gouvernement du Québec.https://www.bei.gouv.qc.ca/communiques/details/2543
(BEI) Bureau des enquêtes indépendantes. (2025b, 30 mars). Le BEI annonce le déclenchement d’une enquête à Montréal le 30 mars 2025. Gouvernement du Québec. https://www.bei.gouv.qc.ca/communiques/details/2544
(BEI) Bureau des enquêtes indépendantes. (2025c, 31 mars). Intervention policière à Montréal le 30 mars 2025 – Témoins recherchés. Gouvernement du Québec. https://www.bei.gouv.qc.ca/communiques/details/2545
(BEI) Bureau des enquêtes indépendantes. (2025d, 31 mars). Le BEI annonce le déclenchement d’une enquête à Québec le 30 mars 2025. Gouvernement du Québec. https://www.bei.gouv.qc.ca/communiques/details/2546
(BEI) Bureau des enquêtes indépendantes. (2025e, 14 avril). Statistiques. Gouvernement du Québec.https://www.bei.gouv.qc.ca/enquetes/statistiques
Bowker, Lynne. (2001). Terminology and Gender Sensitivity : A Corpus-Based Study of the LSP of Infertility.Language in society, 30(4), 589-610.
CBC News. (2025, 30 mars). BEI launches 2 investigations into Montreal police over the weekend. CBC, News, Montreal. https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/police-intervention-montreal-death-1.7497356
Chei Creation [@cheicreation]. (2025, 7 avril). On March 30th, a young father died under unknown circumstances during an intervention by the SPVM . Instagram. https://www.instagram.com/reel/DIIie5OiKuG/
(CLAC) Convergence des Luttes AntiCapitalistes. (2021). HIS-1312 – Introduction et histoire de la police (Saison 1, Épisode 1) [transcription de balado]. Dans Le verger au complet. La CLAC. https://www.clac-montreal.net/fr/node/763
Clash Montréal [@clashmtl@kolektiva.social]. (2025a, 1er avril). ALL EYES ON SAINT-LÉONARD [communiqué]. Mastodon. https://kolektiva.social/@clashmtl/114266217912067386
Clash Montréal [@clashmtl@kolektiva.social]. (2025b, 6 avril). CE N’EST QU’UN DÉBUT [communiqué]. Mastodon. https://kolektiva.social/@clashmtl/114294270284723719
CTV News. (2025, 31 mars). Man shot and killed during police investigation, BEI investigating. [reportage]. CTV News, Montreal Watch. https://www.ctvnews.ca/montreal/video/2025/03/31/man-shot-and-killed-during-police-investigation-bei-investigating/
Edgar, Robin. (2025, 5 avril). Vigile Pour Commémorer Les Victimes De La Police De FRUeS et Collectif 15 mars le 6 Avril 2025 [Vidéo Youtube]. Youtube. https://youtu.be/oCpJczXuY70
Émond, Ariane; Séguin, Charles. (2025, 7 avril). Mort d’Abisay Cruz : « c’est le genre d’événement qui traumatise tout le monde ». Radio-Canada, Info, Justice et faits divers, Forces de l’ordre, Grand Montréal. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2154273/manifestations-abisay-spvm-mort-police
Ferah, Mayssa. (2025, 6 avril). Manifestation en hommage à Abisay Cruz. La Presse, Actualité, Grand Montréal. https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2025-04-06/mort-dans-une-intervention-policiere/manifestation-en-hommage-a-abisay-cruz.php
Front Rose. (2025a, 31 mars). Trois morts en vingt-quatre heures aux mains des policiers de Québec et de Montréal .Front Rose, Actualité, commentaire. https://frontrose.gay/trois-morts-en-48-heures-aux-mains-des-policiers-de-quebec-et-de-montreal/
Front Rose. (2025b, 2 avril). Justice pour Abisay. Front Rose, Actualité, commentaire. https://frontrose.gay/justice-pour-abisay/
Front Rose. (2025c, 7 avril). Une deuxième journée de manifestation pour AbisayCruz !.Front Rose, Actualité, commentaire. https://frontrose.gay/violence-policiere-courage-populaire/
Hawryluk, Markian ; Rayasam, Renuka. (2023, 16 octobre). Doctors abandon « excited delirium » diagnosis used to justify police custody deaths. It might live on, anyway. CBC, News, US. https://www.cbsnews.com/news/excited-delirium-doctors-abandon-diagnosis-police-custody-deaths/
La converse Communauté [@laconversecommunaute]. (2025, 7 avril). Plusieurs personnes se sont rassemblées hier à Saint-Michel pour rendre hommage à Abisay Cruz, tué lors d’une intervention policière du @SPVM la fin de semaine dernière [reportage instragram, par Leroux Nega, Emmanuel [@emmanuel.ln]]. Instragram. https://www.instagram.com/reel/DIJ1nAcxeKp/
Langlois, Marianne. (2025, 6 avril). Mort lors d’une intervention policière: une marche en mémoire du défunt. TVA Nouvelles, Actualité, Info patrouille. https://www.tvanouvelles.ca/2025/04/07/marche-en-lhonneur-dun-jeune-de-montreal-nord
Ligue des Droits et Libertés (LDL) et la Coalition contre la Répression et les Abus Policiers (CRAP). (2020a, mars). REGARDS CRITIQUES sur les trois premières années d’activité du Bureau des enquêtes indépendantes [rapport]. LDL et CRAP. https://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/2020/09/rapport-bei-2020_60pages_couleurs_20200309.pdf
Ligue des Droits et Libertés (LDL) et la Coalition contre la Répression et les Abus Policiers (CRAP). (2020b, mars). Le DPCP et les enquêtes indépendantes [texte complémentaire]. LDL et CRAP. https://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/2020/09/rapport_bei_2020_texte_complementaire_dpcp.pdf
Louve Rose. (2025, 4 avril). Villanueva 17 ans plus tard. Front Rose, Actualité, commentaire, luttes. https://frontrose.gay/villanueva-17-ans-plus-tard/
Madoc-Jones, Gareth. (2025, 7 avril). Questions emerge about level of force used in Montreal police intervention that preceded man’s death. City News, Montreal. https://montreal.citynews.ca/2025/04/07/march-montreal-honours-abisay-cruz/
ONZ Montreal. (2025, 3 avril). Décès suite à une intervention policière à MTL: Un proche de la famille d’Abisay Cruz raconte. [entrevue vidéo]. Youtube. https://youtu.be/XKG4U_G3XXM
Organisatrices de la vigile en l’honneur des trois personnes tuées par la police entre le 29 et le 30 mars 2025 au soi-disant Québec. (2025, s.d.). La police continue de tuer, abolissons-la maintenant ! Montréal Contre-information.https://mtlcontreinfo.org/la-police-continue-de-tuer-abolissons-la-maintenant/
Pilon, Francis. (2025, 1er avril). [VIDÉO] Abisay Cruz: Vigie pour l’homme mort durant une intervention policière. Journal de Montreal, Actualité. https://www.journaldemontreal.com/2025/04/01/video-abisay-cruz-vigie-pour-lhomme-mort-durant-une-intervention-policiere
Popovic, Alexandre. (2025, 31 mars). Week-end meurtrier pour le SPVM. Pivot, chroniques. https://pivot.quebec/2025/03/31/week-end-meurtrier-pour-le-spvm/
Potvin, Maryse. (2014). The reasonable accommodations crisis in Quebec: Racializing rhetorical devices in media and social discourse. International Journal of Canadian Studies, 50(-1), 137-164.https://doi.org/10.3138/ijcs.2014.009
Robidas, Pascal. (2025, 8 avril). Vives tensions entre des jeunes et la police dans le quartier Saint-Michel. Radio-Canada, Info, Justice et faits divers, Prévention et sécurité, Grand Montréal. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2154459/manifestations-st-michel-mort-abisay-cruz-arrestations
Thibault, Eric ; Séguin, Félix ; Lamontagne, Kathryne. (2025, 5 avril). SUR LA TRACE DE DAVE «PIC» TURMEL & DU BFM : LA TRAQUE. Journal de Montréal. https://www.journaldemontreal.com/2025/04/05/entrez-dans-les-coulisses-de-la-lutte-a-la-violence-armee-a-quebec-et-de-la-traque-du-caid-dave–pic–turmel
Yanez-Leyton, Cassandra. (2025, 6 avril). Montrealers rally around family of man who died after police operation in Saint-Michel. CBC, News, Montreal. https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/march-abisay-cruz-spvm-bei-investigations-1.7503358
WSC Montreal [@wsc.montreal]. (2025a, 1er avril). Pourquoi les nouvelles cachent-elles la vérité ? Que se passe-t-il à Montréal ? Un jeune homme de 29 ans a été t*é par la SPVM, et PERSONNE n’en parle ?[vidéoinstragram]. Instagram. https://www.instagram.com/reel/DH7UsFFujDP/
WSC montreal [@wsc.montreal]. (2025b, 6 avril). Scenes emerging from today’s protest against police violence in the streets of Montreal . Instagram. https://www.instagram.com/reel/DIIToO6usSL/
WSC montreal [@wsc.montreal]. (2025c, 6 avril). Spotted in PIW-IX … . Instagram. https://www.instagram.com/reel/DIH00RpPlYL/
WSCmontreal [@wsc.montreal] ; Hernandez, Branny [@mr.coucou] (interviewer). (2025, 7 avril). ABISAY CRUZ (BICHA) BRUTALITÉ POLICIÈRE [reportage vidéo). Instagram. https://www.instagram.com/reel/DIHKSKquDxA/
[1] L’Agence de presse QMI produit et traite des textes, des photos et des vidéos et les distribue aux médias appartenant à Québecor, le chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d’information et de la culture. (Agence QMI, s.d.).
[2] D’ailleurs cela fait écho à une enquête, sans lien avec l’affaire, mais publiée dans la semaine suivant le meurtre d’Abisay et d’A. L’enquête légitime les interventions policières via la panique morale : la guerre aux stupéfiants.
[3]Voici deux vidéos documentant la manifestation : (CheiCreation, 2025 ; La Converse Communauté, 2025).
[4]Voici une vidéo documentant la vigile : (Edgar, 2025)
[5] Voici deux vidéos d’arrestations brutales : (WSC Montreal, 2025b; WSC Montreal 2025c). Sans compter plusieurs témoignages et vidéos perçus, qui n’ont pas été rendus publiques.
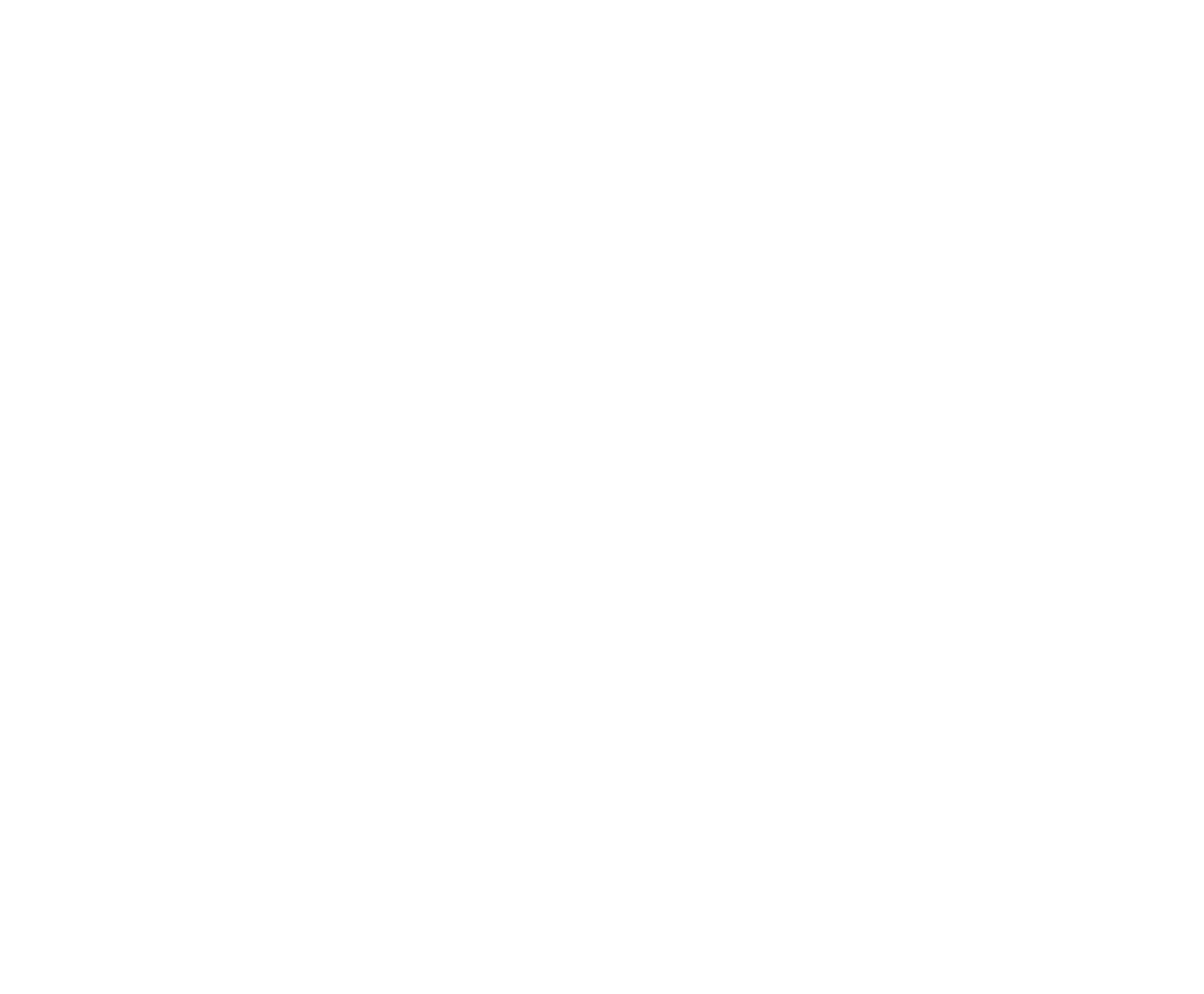
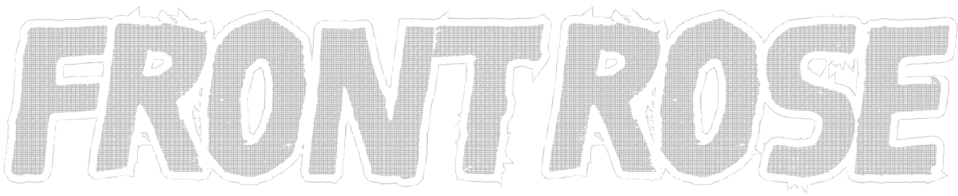

Super texte, merci pour la rigueur !