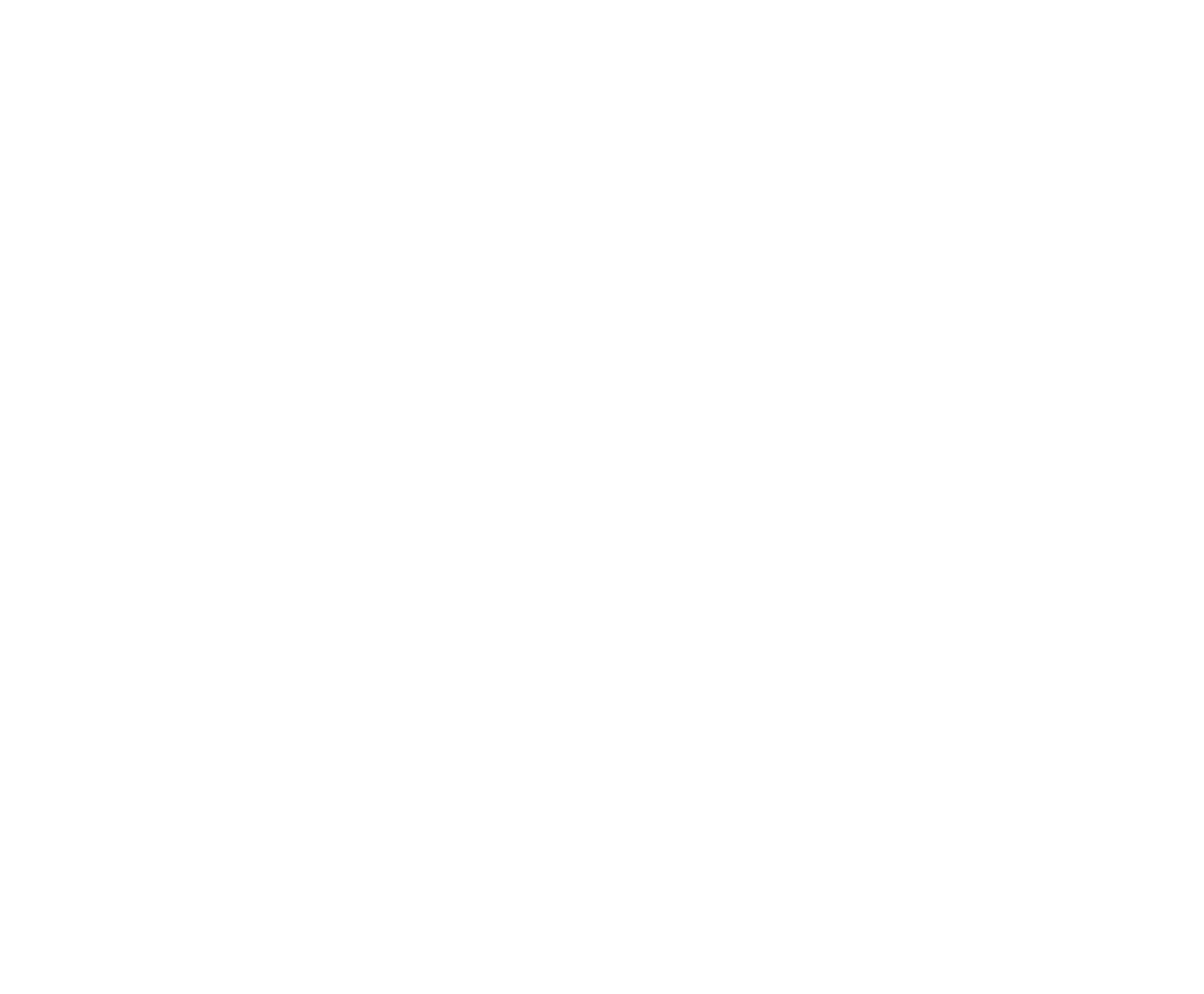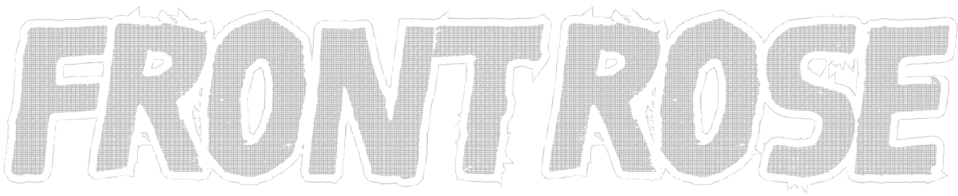Villanueva dix-sept ans plus tard
Rien n’a changé et le combat continue
Par Louve Rose
Le 9 août 2008, Fredy Villanueva est tué sous les balles de la police.
Son assassinat par le SPVM sera suivi par des émeutes et la question suscitera de nombreux débats.
Le 31 mars 2016, Bony Jean-Pierre meurt après qu’un policier lui ait tiré dessus à l’aide d’un projectile supposément non létal alors qu’il tentait de s’éloigner. Une émeute éclate quelques jours plus tard. Des enquêtes sont lancées.
En juin 2020, une large manifestation, s’inscrivant dans le mouvement global contre la police et le racisme ayant suivi l’assassinat de George Floyd à Minneapolis aux États-Unis, est organisée au centre-ville de Montréal. L’intervention de l’anti-émeute et l’utilisation de gaz lacrymogène transforment la manifestation en émeute. Rapidement, l’appareil politique et médiatique libéral se met en marche pour pacifier le mouvement. On prétend que des efforts seront faits pour se pencher sur la question des violences policières.
Le 30 mars 2025, aux petites heures du matin, une intervention policière violente coûte la vie à Abisay Cruz. Les violences policières sont documentées sur les médias sociaux. La veille, tard en soirée, un autre homme perdait la vie aux mains de la police au centre-ville de Montréal. Le même jour, une troisième personne perd la vie alors qu’elle est en détention à Québec. Les médias ne couvrent pratiquement pas l’affaire.
Dix-sept ans après la mort de Fredy, huit ans après celle de Bony, cinq ans après les soulèvements de 2020, tout ce qui a changé, c’est la banalisation du mal. La normalisation de la violence. Alors que les médias sociaux débordent d’images montrant le harcèlement, la violence et l’intimidation exercées par le SPVM et les constables de la STM, les médias choisissent de prendre le parti des interventions policières — ou, plus simplement, de ne plus vouloir en parler. Le conseil municipal augmente le budget du SPVM à hauteur de 40 millions et met en place des règlements pour faciliter le harcèlement et la répression des communautés itinérantes. Les manifestations pour la Palestine, les droits trans, les luttes syndicales, ou n’importe quels autres sujets qui dérangent le pouvoir, sont de plus en plus violemment réprimés.
J'ai passé mon adolescence dans l'est de Montréal entre Mercier, Saint-Léonard, Nouveau-Rosemont, Saint-Michel et Hochelaga. Partout, c'était clair, et d'autant plus pour les ami·es immigrées qui m'ont initié à la politique de rue, que la police existe pour nous imposer sa terreur. Patrouille autour de l'école secondaire, harcèlement dans la rue, intimidation, profilage, interventions violentes, c'est toute la jeunesse des quartiers qui se faisait traiter comme un peuple sous occupation. J'ai dix ans de moins que Fredy. En dix ans rien n'avait changé dans le rapport des flics aux quartiers.Loin de tout progrès, un regard rétrospectif sur la séquence d’évènements ayant suivi la mort de Fredy Villanueva laisse entrevoir que c’est la police qui a gagné. Un policier, sous le couvert de l’anonymat, avait déclaré à l’époque : « on ne laisse plus rien passer ». Force est de constater qu’ils ont eu ce qu’ils voulaient. Le support de la classe politique et de la majorité des médias pour le corps policier est sans équivoque. Depuis 2020, l’épouvantail des gangs de rues, du trafic de stupéfiants et, plus récemment, de la « cohabitation » a servi à légitimer une augmentation continue des dépenses — et de leur impunité. La police attaque les journalistes, terrorise les communautés vulnérables, démantèle les campements d’itinérants, et continue d’être défendue, voire célébrée pour ses actions. Le BEI supposé empêcher les bavures ouvre enquête après enquête sans que les policiers n’aient jamais à s’inquiéter des conséquences. Pire, le BEI publie des rapports qui ne font que répéter les versions de la police.
À chaque manifestation, mes proches me demandent de faire attention, de ne pas prendre trop de risques, de me protéger. Personne ne se dit que la police va bien se comporter. Je porte dans mon corps et mon esprit les conséquences de 10 ans de brutalité, de coups, de gaz, d'harcèlement. J'ai vécu sous la peur des charges, en attente d'une sentence. Pourtant, je suis loin d'avoir vécu le pire de la violence que ce système a à offrir. Qui pleure les orphelins de violences policières sur les grands plateaux télé ? Qui, au parlement, s'insurge lorsque le bras armé de l'état assassine ? Combien de vies perdues sans preuves vidéo ? Combien de vies détruites sous de fausses charges ? Combien d'assassins en uniforme ? Des bons pères de famille banlieusards, armés et entrainés, patrouillent nos rues en traitant nos voisin·es, ami·es et relations comme des menaces à pacifier.
Les appels aux réformes du corps policier, à la responsabilisation de la classe politique, à la démocratisation de la sécurité, à la surveillance citoyenne ne mènent nulle part. La police — qui agit comme une armée d’occupation — traite les populations urbaines, immigrantes, pauvres, autochtones, queer et trans, de gauche, travailleuses du sexe, racisées et la jeunesse comme des forces ennemies à dominer et à maitriser.
N'oublions pas que chaque mort, chaque blessé est aussi un moyen pour la police d'instaurer la peur. Je n'y crois plus quand on nous dit que ce sont des accidents, des erreurs de parcours. Ça fait partie du fonctionnement de la machine. La police veut qu'on la craigne. Pire, elle a besoin de la terreur pour fonctionner. Les meurtres et les bavures servent d'exemples, de spectacle pour chercher à pacifier les esprits. Sert à ce qu'un agent et son collègue se sentent à l'aise d'intimider une douzaine de jeunes qui chillent dans un parc. Ils cultivent la terreur pour s'assurer de notre docilité. Ils s'en foutent qu'on les filme. Ils agressent sur caméra, parfois le sourire aux lèvres. La paix sociale est maintenue par la terreur et rien d'autre.
Dix-sept ans après Fredy, une chose est claire : on ne peut pas sauver la police. Le seul moyen d’éviter les bavures, les violences, les morts et, plus généralement, le climat de terreur entretenu par la simple présence policière, c’est de faire changer la peur de camp. Il faut que le coût politique et matériel associé à de telles horreurs soit trop immense pour être assumé par la classe politique. De toute manière, nous ne serons jamais assez « sages » pour que les médias nous préfèrent à la police. Dans ce contexte, assurons-nous de faire regretter aux dominants leurs violences. C’est lorsque nous descendons dans la rue en masse, avec détermination et solidarité, que le changement devient possible ! Aujourd’hui, pour Abisay Cruz. Mais demain, pour les autres.
Organisons-nous localement pour que la police ne se sente à l’aise dans aucun quartier. Assurons-nous de soutenir les enjeux matériels, psychologiques et sociaux de nos voisin·es, et que tout le monde comprenne bien que la police est et restera toujours notre ennemi, à toustes celleux qui luttent pour survivre face à un système qui tue et opprime. Il faut s’unir au-delà non seulement des prétendues frontières qui existent entre nos quartiers, mais aussi entre communautés immigrantes, autochtones et racisées, queer et trans, entre personnes de la rue, prolétaires, militant·es de gauche et d’extrême-gauche, entre militant·es palestinien·nes, syndicats et personnes de conscience. La police est notre ennemi commun, et face à elle nous devons être solidaires à tout prix.
Il n’y a pas de bonne police. Il n’y a pas de bons oppresseurs. Il faut croire nos communautés et rendre leur système obsolète.
Honorons les morts et battons-nous férocement pour les (sur)vivant·es !
You have to act as if it were possible to radically transform the world. And you have to do it all the time.
– Angela Davis